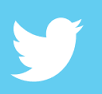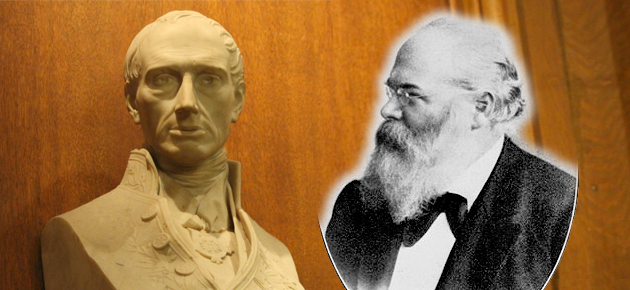
Si des cas particuliers de l’inégalité de Cauchy‒Schwarz, ou tout simplement de Cauchy, ou de Schwarz, ou encore de Bouniakowsky, ont été utilisés depuis longtemps dans des démonstrations mathématiques, sa première formulation, accompagnée d’une démonstration, la considérant ainsi comme un résultat d’intérêt en lui-même, est l’œuvre de Cauchy.
Cauchy et l’inégalité numérique
Augustin-Louis Cauchy s’empare le premier du sujet dans la note 2 de son Analyse géométrique, qui reprend son cours dispensé à l’École polytechnique et qui est publié en 1821. La note s’intitule Sur les formules qui résultent de l’emploi du signe > ou <, et sur les moyennes entre plusieurs quantités.
Après l’énoncé de nombreuses inégalités évidentes ou classiques, le quinzième théorème affirme :
Soient a, a′, a″… des quantités quelconques, en nombre n. Si ces quantités ne sont pas toutes égales entre elles, la valeur numérique de la somme a + a′ + a″+… sera inférieure au produit de sorte que l’on aura :
On remarque que Cauchy n’utilise pas de symbole particulier pour noter la valeur absolue, qu’il nomme valeur numérique.
On retrouve au théorème suivant l’inégalité dite de Cauchy, que le mathématicien exprime ainsi :
Soient a, a′, a″… α, α′, α″… deux suites de quantités, et supposons que ces suites renferment un nombre n de termes. Si les rapports ne sont pas tous égaux, la somme aα + a′ α′ + a″α″+… sera inférieure au produit
Pour démontrer ce résultat, Cauchy ajoute au carré de la quantité aα + a′α′+ a″α″+… une somme de carrés de telle sorte que l’on obtienne la quantité
(a2 + a′ 2 + a″ 2+…) × (α2 + α′ 2 + α′′ 2 +…).
Il conclut en prenant les racines carrées positives des deux termes.

Augustin-Louis Cauchy (1789‒1857).
Bouniakowsky et les intégrales
Victor Bouniakowsky est un contemporain de Pafnouti Tchebychev. Comme son illustre compatriote, il s’intéresse au calcul des probabilités et publie en 1846 un ouvrage sur ce thème.
Dans un article rédigé en français treize ans plus tard, il justifie diverses inégalités qui lui semblent utiles dans le domaine des probabilités. Sa démarche est de passer du contexte fini (avec des sommes et des moyennes) au domaine continu (à l’aide d’intégrales), ce qu’il explique ainsi.
La considération des moyennes arithmétiques des fonctions d’une ou plusieurs variables qui varient par degrés insensibles conduit au calcul intégral de la manière la plus naturelle, la plus élégante et la plus satisfaisante sous le rapport de la clarté.
Le savant russe emploie ainsi, pour l’intégrale, les termes utilisés dans le cas fini et nomme moyenne arithmétique de la fonction f , « pour toutes les valeurs de la variable réelle x depuis x = x0 jusqu’à x = X », la quantité
De la même façon, il effectue des passages du discret au continu pour les moyennes géométriques et harmoniques.
Sans citer Cauchy, Bouniakowsky introduit alors la relation bien connue
Il poursuit en affirmant :
Si l’on suppose que les nombres a1, a2, a3… an soient les valeurs successives de la fonction continue φ depuis x = x0 jusqu’à x = X et que b1, b2, b3… bn représentent la suite des valeurs d’une autre fonction continue ψ entre les mêmes limites, l’inégalité précédente se trouvera remplacée par la suivante :
L’assertion ne s’appuie sur aucune preuve. Les constructions de l’intégrale des fonctions continues présentées par Cauchy en 1821 ne sont pas même évoquées, ni son extension datant de 1854, œuvre du mathématicien allemand Bernhard Riemann. La formule est donnée avec une inégalité stricte dans le cas discret sans préciser que les deux n-uplets ne doivent pas être proportionnels ; quant à son maintien à la limite, il n’est pas justifié. Pourtant, le savant russe est conscient de cette subtilité puisqu’il ajoute que cette formule « se réduit à l’égalité pour ψ(x) = λφ(x) », λ étant une constante.
Bouniakowsky, des probabilités à la théorie des nombres
Viktor Bouniakowsky voit le jour en 1804 à Bar, une petite ville située près de Vinnitsa en Ukraine actuelle. Son enfance se passe à Saint-Pétersbourg où il reçoit une formation mathématique à la maison par un ami de la famille. Il se rend à Paris pour parfaire sa formation ; il suit des cours de Pierre-Simon Laplace (1749‒1827) et Siméon Denis Poisson (1781‒1840) ; il obtient son doctorat à la Sorbonne sous la direction de Cauchy.
À son retour en Russie, Bouniakowsky enseigne à Saint-Pétersbourg et joue un rôle important dans le développement des mathématiques dans son pays. Ses travaux concernent la mécanique théorique mais aussi le calcul des probabilités. On le considère, avec son compatriote Pafnouti Tchebychev, comme le fondateur de l’école russe de probabilités.
Bouniakowsky s’intéresse également à la théorie des nombres, domaine dans lequel il énonce en 1854 une conjecture, toujours ouverte, concernant les polynômes et les nombres premiers. Prenez un polynôme P à coefficients entiers (relatifs), de degré au moins égal à 2, irréductible sur l’ensemble des rationnels. Soit d le PGCD des valeurs |P(n)| lorsque n parcourt l’ensemble des entiers. La conjecture de Bouniakowsky avance alors qu’il existe une infinité d’entiers naturels n pour lesquels l’entier |P(n)| / d est un nombre premier.
Il décède à Saint-Pétersbourg en 1889.

Schwarz entre en scène
Un quart de siècle plus tard, le mathématicien allemand Hermann Schwarz (1843‒1921) s’intéresse à son tour à la fameuse relation. Cet élève de Karl Weierstrass (1815‒1897) travaille, comme son maître, dans le domaine de l’analyse et de ses applications à l’étude des surfaces. C’est dans un article concernant la recherche de surfaces minimales que l’on trouve énoncée et démontrée l’inégalité qui nous intéresse dans le cadre de l’intégration.
Schwarz considère deux fonctions de deux variables, φ et χ, absolument intégrables sur un domaine T du plan telles que le quotient des fonctions φ et χ ne soit pas une constante.
Il pose alors les trois quantités suivantes :
Schwarz considère alors la forme quadratique ci-dessous :
Il remarque alors que le discriminant de cette forme quadratique est positif,
soit AC ‒ B2 > 0, et donc qui est bien l’inégalité dite de Schwarz pour les intégrales.
Comme on le voit, sa démonstration peut tout à fait s’adapter au formalisme actuel des espaces euclidiens.
Mais, à cette époque, la notion de produit scalaire est tout juste naissante et la formalisation de l’axiomatique des espaces euclidiens et hermitiens attendra le début du XXe siècle, sans doute en 1918 sous la plume du mathématicien allemand Hermann Weyl (1885‒1955). C’est alors que l’on pourra définir l’inégalité de Cauchy‒Bouniakowsky‒Schwarz sous une forme englobant les n-uplets chers à Cauchy et les intégrales, et l’écrire de manière condensée
Le nom du mathématicien russe a été oublié pour nommer cette belle et puissante inégalité, sauf dans son pays.
Schwarz, de la chimie aux mathématiques
Karl Hermann Amandus Schwarz naît en 1843 dans le village de Hermsdorf, actuelle Jerzmanowa en Silésie polonaise. Il entame des études universitaires axées sur la chimie à Berlin, mais se tourne finalement vers les mathématiques. Il suit les cours de Weierstrass et de Kummer, et obtient son doctorat en 1864. Il enseigne successivement à Halle, Zurich et Göttingen, avant de succéder à Weierstrass à l’université de Berlin en 1892.
Schwarz justifie en 1873 l’interversion de l’ordre des dérivations partielles dans le cas où les deux dérivées partielles et les quatre dérivées secondes partielles de la fonction sont continues et fournit un contre-exemple pour convaincre du besoin de ces hypothèses. Il donne en 1884 une preuve du problème isopérimétrique en dimension 3. Il démontre la même année l’inégalité dite de Cauchy‒Schwarz dans le cadre des intégrales doubles.